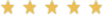MA-ID: 620502090
Évaluations Numex OÜ
Excellent seller, highly recommended!
Thank You! Nice items for reasonable price, quick shipping! Excellent!!!
Ja, ich bin mit dem gekauften Geldschein vollig zufrieden. Danke.
M.Brindz...
Super Ware! Gerne wieder.
Erzbistum Mainz Obol / Hälbling ND (983-1002) Otto III (983-1002) - Rare ! F
Numex OÜ 

9
Sur MA-Shops depuis 9 années
1195 évaluations,
100 % Positif ( derniers 24 mois )
Expédition dans le monde entier
400,00 EUR
TVA n'est pas applicable ou ne peut pas être indiqué sur la facture.
+ 5,00 EUR frais d'envoi ( vers France métropolitaine )
Délai de livraison : 17 à 20 jours
+ 5,00 EUR frais d'envoi ( vers France métropolitaine )
| +49 (0)2871 2180 383 |
| Modes de paiement |
| virement bancaire |
Avers : Croix avec des globules dans les angles.
Revers : Chapelle surmontée d'une croix
Traces de test : marques de piquage
Diamètre : 15 mm
Analyse numismatique et historique de l’Obol de l’Archevêché de Mayence, Otto III (983–1002), ND
Introduction
L’Obol, ou Hälbling, de l’Archevêché de Mayence, frappé pendant le règne d’Otto III (983–1002), est un artefact rare et significatif de la monnaie allemande du début du Moyen Âge. Classé F (Fin) avec des marques de test (peck-marks), catalogué sous Dannenberg 780, Walther 9 et Bonhoff 1705, cette pièce en argent pèse 0,35 gramme et mesure 15 mm de diamètre. Arborant une croix avec des pastilles dans les coins à l’avers et une chapelle avec une croix au revers, cette pièce incarne le pouvoir ecclésiastique de Mayence et les ambitions impériales de la dynastie ottonienne. Sa rareté, combinée à son contexte historique, en fait une pièce précieuse pour les numismates et les historiens explorant le Saint-Empire romain germanique à la fin du Xe siècle.
Contexte historique
Otto III, couronné roi des Allemands en 983 à l’âge de trois ans et empereur du Saint-Empire romain germanique de 996 jusqu’à sa mort en 1002, fut une figure centrale de la dynastie ottonienne. Son règne, initialement guidé par des régents tels que sa mère Théophano et sa grand-mère Adélaïde, visait à raviver la grandeur d’un empire chrétien inspiré des traditions romaines. Les politiques d’Otto III mettaient l’accent sur le renforcement des institutions ecclésiastiques, l’Archevêché de Mayence jouant un rôle central en tant que centre spirituel et politique. Les archevêques de Mayence, souvent chanceliers impériaux, exerçaient une influence considérable, faisant de l’atelier monétaire de Mayence un producteur clé de monnaies symbolisant à la fois l’autorité religieuse et séculière.
Frappé pendant le règne d’Otto III (983–1002), cet obol reflète le rôle économique et symbolique de la monnaie dans le Saint-Empire romain germanique. La période était marquée par des efforts pour stabiliser l’économie grâce à une monnaie en argent cohérente, essentielle pour le commerce et les tributs dans un empire décentralisé. La présence de marques de test – petites entailles ou rayures – indique que la pièce a été testée pour sa pureté en argent, une pratique courante dans l’Europe médiévale pour garantir la confiance dans la monnaie, en particulier dans les régions avec des réseaux commerciaux actifs, y compris ceux influencés par le commerce viking le long du Rhin.
Description numismatique
Avers
L’avers présente une croix avec des pastilles (dites boules) dans les coins, un design minimaliste mais riche en symbolisme. La croix, emblème chrétien universel, souligne l’autorité ecclésiastique de l’Archevêché de Mayence, tandis que les pastilles servaient probablement de marqueurs décoratifs ou spécifiques à l’atelier. L’absence d’inscription est typique pour les petites dénominations comme l’obol, privilégiant une iconographie claire pour garantir la reconnaissance dans les transactions locales.
Revers
Le revers montre une chapelle stylisée surmontée d’une croix, un motif courant dans la monnaie ottonienne qui met en avant le statut de Mayence en tant que centre ecclésiastique majeur. Le design de la chapelle symbolise le pouvoir spirituel et temporel de l’Église, la croix renforçant les fondements chrétiens de la règle impériale. La simplicité du design reflète l’objectif pratique de l’obol en tant que dénomination fractionnaire pour un usage quotidien.
Matériau et spécifications
Frappée en argent, la pièce pèse 0,35 gramme et a un diamètre de 15 mm, conforme à l’obol ou hälbling, une petite dénomination utilisée pour des transactions mineures. Son grade F indique une usure modérée, avec des marques de test suggérant une circulation active et des vérifications d’authenticité. La teneur en argent garantissait sa fiabilité dans le commerce, en particulier dans la région du Rhin, où Mayence était un centre économique vital.
Importance numismatique
L’Obol de Mayence est un exemple rare de monnaie ottonienne, reflétant l’intersection de l’autorité ecclésiastique et impériale à la fin du Xe siècle. Sa petite taille et son poids le rendaient idéal pour le commerce local, tandis que son iconographie chrétienne reliait l’Archevêché de Mayence au projet impérial plus large d’Otto III. Catalogué sous Dannenberg 780, Walther 9 et Bonhoff 1705, sa rareté augmente son attrait pour les collectionneurs et les chercheurs.
Les marques de test fournissent des preuves de l’utilisation active de la pièce dans le commerce, offrant un aperçu des pratiques économiques médiévales où la vérification de la pureté de l’argent était cruciale. Les motifs de la croix et de la chapelle soulignent le rôle de l’Église dans la standardisation de la monnaie et l’affirmation de l’autorité dans un empire fragmenté. La production de la pièce à Mayence, un atelier de premier plan, met en évidence l’importance de la ville dans le système monétaire du Saint-Empire romain germanique, où les centres ecclésiastiques contrôlaient souvent la production de monnaies.
Cet obol témoigne également des capacités techniques et artistiques de l’atelier de Mayence, qui produisait des pièces de qualité constante malgré les défis d’une économie décentralisée. Son association avec Otto III le relie à une période transformatrice de l’histoire européenne, marquée par des efforts pour unifier l’empire sous une idéologie impériale chrétienne.
Conclusion
L’Obol de l’Archevêché de Mayence, frappé sous le règne d’Otto III (983–1002), est une relique rare et évocatrice du début du Moyen Âge allemand. Son design de croix et de chapelle, sa composition en argent légère et son état marqué par des tests reflètent les dynamiques économiques, religieuses et politiques de l’Archevêché de Mayence à l’ère ottonienne. En tant que produit d’un centre monétaire de premier plan, il incarne la fusion du pouvoir ecclésiastique et de l’ambition impériale. Pour les numismates et les historiens, cette pièce offre une connexion tangible au règne d’Otto III et à l’histoire complexe du Saint-Empire romain germanique à la fin du Xe siècle.
Revers : Chapelle surmontée d'une croix
Traces de test : marques de piquage
Diamètre : 15 mm
Analyse numismatique et historique de l’Obol de l’Archevêché de Mayence, Otto III (983–1002), ND
Introduction
L’Obol, ou Hälbling, de l’Archevêché de Mayence, frappé pendant le règne d’Otto III (983–1002), est un artefact rare et significatif de la monnaie allemande du début du Moyen Âge. Classé F (Fin) avec des marques de test (peck-marks), catalogué sous Dannenberg 780, Walther 9 et Bonhoff 1705, cette pièce en argent pèse 0,35 gramme et mesure 15 mm de diamètre. Arborant une croix avec des pastilles dans les coins à l’avers et une chapelle avec une croix au revers, cette pièce incarne le pouvoir ecclésiastique de Mayence et les ambitions impériales de la dynastie ottonienne. Sa rareté, combinée à son contexte historique, en fait une pièce précieuse pour les numismates et les historiens explorant le Saint-Empire romain germanique à la fin du Xe siècle.
Contexte historique
Otto III, couronné roi des Allemands en 983 à l’âge de trois ans et empereur du Saint-Empire romain germanique de 996 jusqu’à sa mort en 1002, fut une figure centrale de la dynastie ottonienne. Son règne, initialement guidé par des régents tels que sa mère Théophano et sa grand-mère Adélaïde, visait à raviver la grandeur d’un empire chrétien inspiré des traditions romaines. Les politiques d’Otto III mettaient l’accent sur le renforcement des institutions ecclésiastiques, l’Archevêché de Mayence jouant un rôle central en tant que centre spirituel et politique. Les archevêques de Mayence, souvent chanceliers impériaux, exerçaient une influence considérable, faisant de l’atelier monétaire de Mayence un producteur clé de monnaies symbolisant à la fois l’autorité religieuse et séculière.
Frappé pendant le règne d’Otto III (983–1002), cet obol reflète le rôle économique et symbolique de la monnaie dans le Saint-Empire romain germanique. La période était marquée par des efforts pour stabiliser l’économie grâce à une monnaie en argent cohérente, essentielle pour le commerce et les tributs dans un empire décentralisé. La présence de marques de test – petites entailles ou rayures – indique que la pièce a été testée pour sa pureté en argent, une pratique courante dans l’Europe médiévale pour garantir la confiance dans la monnaie, en particulier dans les régions avec des réseaux commerciaux actifs, y compris ceux influencés par le commerce viking le long du Rhin.
Description numismatique
Avers
L’avers présente une croix avec des pastilles (dites boules) dans les coins, un design minimaliste mais riche en symbolisme. La croix, emblème chrétien universel, souligne l’autorité ecclésiastique de l’Archevêché de Mayence, tandis que les pastilles servaient probablement de marqueurs décoratifs ou spécifiques à l’atelier. L’absence d’inscription est typique pour les petites dénominations comme l’obol, privilégiant une iconographie claire pour garantir la reconnaissance dans les transactions locales.
Revers
Le revers montre une chapelle stylisée surmontée d’une croix, un motif courant dans la monnaie ottonienne qui met en avant le statut de Mayence en tant que centre ecclésiastique majeur. Le design de la chapelle symbolise le pouvoir spirituel et temporel de l’Église, la croix renforçant les fondements chrétiens de la règle impériale. La simplicité du design reflète l’objectif pratique de l’obol en tant que dénomination fractionnaire pour un usage quotidien.
Matériau et spécifications
Frappée en argent, la pièce pèse 0,35 gramme et a un diamètre de 15 mm, conforme à l’obol ou hälbling, une petite dénomination utilisée pour des transactions mineures. Son grade F indique une usure modérée, avec des marques de test suggérant une circulation active et des vérifications d’authenticité. La teneur en argent garantissait sa fiabilité dans le commerce, en particulier dans la région du Rhin, où Mayence était un centre économique vital.
Importance numismatique
L’Obol de Mayence est un exemple rare de monnaie ottonienne, reflétant l’intersection de l’autorité ecclésiastique et impériale à la fin du Xe siècle. Sa petite taille et son poids le rendaient idéal pour le commerce local, tandis que son iconographie chrétienne reliait l’Archevêché de Mayence au projet impérial plus large d’Otto III. Catalogué sous Dannenberg 780, Walther 9 et Bonhoff 1705, sa rareté augmente son attrait pour les collectionneurs et les chercheurs.
Les marques de test fournissent des preuves de l’utilisation active de la pièce dans le commerce, offrant un aperçu des pratiques économiques médiévales où la vérification de la pureté de l’argent était cruciale. Les motifs de la croix et de la chapelle soulignent le rôle de l’Église dans la standardisation de la monnaie et l’affirmation de l’autorité dans un empire fragmenté. La production de la pièce à Mayence, un atelier de premier plan, met en évidence l’importance de la ville dans le système monétaire du Saint-Empire romain germanique, où les centres ecclésiastiques contrôlaient souvent la production de monnaies.
Cet obol témoigne également des capacités techniques et artistiques de l’atelier de Mayence, qui produisait des pièces de qualité constante malgré les défis d’une économie décentralisée. Son association avec Otto III le relie à une période transformatrice de l’histoire européenne, marquée par des efforts pour unifier l’empire sous une idéologie impériale chrétienne.
Conclusion
L’Obol de l’Archevêché de Mayence, frappé sous le règne d’Otto III (983–1002), est une relique rare et évocatrice du début du Moyen Âge allemand. Son design de croix et de chapelle, sa composition en argent légère et son état marqué par des tests reflètent les dynamiques économiques, religieuses et politiques de l’Archevêché de Mayence à l’ère ottonienne. En tant que produit d’un centre monétaire de premier plan, il incarne la fusion du pouvoir ecclésiastique et de l’ambition impériale. Pour les numismates et les historiens, cette pièce offre une connexion tangible au règne d’Otto III et à l’histoire complexe du Saint-Empire romain germanique à la fin du Xe siècle.
Info / FAQ
| Frais d'envoi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,00 EUR à 50,00 EUR | 50,00 EUR à 200,00 EUR | 200,00 EUR à 500,00 EUR | plus de 500,00 EUR | |
| Chine | 12,00 EUR | - | - | - |
| Allemagne | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 15,00 EUR |
| Estonie | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 12,00 EUR |
| Royaume-Uni | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 25,00 EUR |
| États-Unis | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 40,00 EUR |
| Union Européenne | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 25,00 EUR |
| Monde | 12,00 EUR | 15,00 EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR |
Shipping Info
Les ventes en ligne sont possible, livraisons internationales parfois avec un peu de retard
|
Page d'accueil de cette boutique | 0Panier | CGV | Mentions légales | MA CGV | Déclaration de protection de données | Garantie | MA-Shops Nouveautés Copyright ® 2001-2025, MA-SHOPS Coins All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. |
 Monnaies et billets
Monnaies et billets +49 (0)2871 2180 383
+49 (0)2871 2180 383